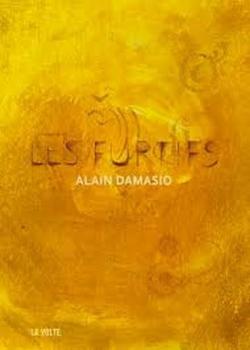Ce n’est pas pour régler des comptes que je commence ce texte long et longtemps retenu.
Quand j’ai appris que Richard Martin entrait de nouveau en grève de la faim pour rester maître de son théâtre, j’ai eu la naïveté de penser que la première municipalité de gauche depuis 25 ans à Marseille, dont j’avais accueilli l’arrivée avec enthousiasme, corrigerait vite l’erreur grossière de mettre le créateur magnifique et à jamais légendaire du théâtre Toursky dans cet insupportable et misérable entonnoir : on monnaye une subvention coupée contre une convention d’un an et ciao. La musique, on ne la connaît que trop. L’autorité place ensuite un ami et il n’y a plus de problème de subvention, on l’augmente même.
Je constate avec stupeur, effroi et bien entendu colère, qu’à ce jour, cette réaction municipale corrective tellement attendue ne vient toujours pas. Et Richard au bout de 16 jours de grève de la faim est désormais hospitalisé.
J’ai besoin de témoigner à propos de ce qu’est Richard.
Je m’exprime d’abord en citoyen-contribuable, amoureux de spectacle qui paye toujours ses billets, vieux marseillais de 62 ans, dans un premier temps témoin lointain des combats de Richard pour que ce lieu existe, dans ce quartier excentré (devenu entretemps l’un des plus pauvres d’Europe).
Je connaissais avant même de rencontrer vraiment Richard Martin une partie des actes les plus spectaculaires qu’il a courageusement posés depuis cinquante ans pour obtenir les moyens de faire de ce lieu ce qu’il est aujourd’hui.
Le Toursky, je l’ai d’abord fréquenté en tant que spectateur sans jamais avoir à me plaindre de la qualité de ce que j’y venais voir, et encore moins de celle de l’accueil. Il faut éprouver la douceur de vivre du lieu, de son hall, de sa terrasse, de son restaurant pour comprendre et ressentir tout ce qu’il s’en dégage de positif, de vibrant. Ici tout le monde a sa place. Il faut voir le sourire ravi de Richard Martin promenant sa silhouette dans tous les recoins les soirs de spectacle, dispensant des mots chaleureux avec son timbre de voix si humain et profond, portant une attention particulière à tout et à tous.
Puis, un événement très spécial m’a permis d’approfondir la connaissance de cet endroit.
Mars 2020, le Covid règne et me voilà confiné comme nous tous. Dès les premières heures, je projette d’apprendre des poésies, une par jour, pour combattre le décompte macabre des morts aux infos (j’en ferai 56). Puis je réouvre le Livre de Jobi de mon ami Henri-Frédéric Blanc. Je l’ai déjà lu quatre ou cinq fois avec toujours le même bonheur. Je décide alors de l’apprendre. Au bout de trois semaines j’ai plus d’une heure de texte en tête et je me décide à appeler l’auteur pour l’informer de cette chose un peu folle : je prends plaisir à déclamer son texte tout seul dans mon salon. Blanc souhaite voir ça. Il vient chez moi, je lui « joue » son livre et il adore ce qu’il voit et entend.
Ensuite ça va très vite. Je dis que je voudrais voir ce qu’il se passerait si je disais ce texte dans un lieu plus grand que mon salon. Henri-Frédéric Blanc m’emmène au Toursky et nous faisons une répétition dans une jolie salle inconnue et inaccessible au public. À la sortie nous tombons sur Richard Martin qui souhaite que je revienne pour lui faire entendre les mots de Blanc. Je travaille quelque temps encore et nous convenons d’un rendez-vous, mais ce jour-là nous le voyons arriver plié en deux par un lumbago terrible. Je suis confus, je lui dis qu’il n’aurait pas dû venir dans cet état, « non, non » me répond-il « j’ai dit que je viendrai et je suis là, de toute façon c’est toi qui vas travailler ». Il m’ouvre la salle Léo Ferré, m’envoie illico sur la scène et s’installe au dernier rang au fond. Je suis pour la première fois de ma vie sur une scène de théâtre alors que je n’en avais même jamais rêvé, il y a au fond Richard Martin, cet homme de spectacle si plein de flamme même s’il n’est guère en forme ce jour-là, et sur ma gauche, mon ami Henri-Frédéric Blanc que je considère comme l’un des plus grands auteurs marseillais vivants, excusez du peu. Je vais rester près de deux heures sur scène à dire ce texte. Pendant toute la séance, j’ai vu Richard souffrir le martyr, sans cesse à la recherche de la position la plus confortable mais ne relâchant pas une fois son écoute. Mais il y a plus fort. Il va encore rester 3/4 d’heure pour me décrire tout ce qu’il me restait à faire si je voulais transformer ma prestation en spectacle seul-en-scène. Je lui confie que je me sentais comme un type qui va sur le Vieux-Port et qui, désignant un grand voilier décide d’y monter sur le champ pour aller traverser l’Atlantique alors qu’il n’a jamais sorti un bateau du port. Richard a alors cette phrase : « Oui, c’est un peu ça. Mais si tu te le répètes, tu ne vas jamais monter sur le bateau ». Il va ajouter derrière ces mots que je n’oublierai jamais : « Je te sens lucide et perspicace sur toi-même. Si tu ne le sens pas tu t’arrêteras. Mais à partir de maintenant, tu es chez toi ici. Tu viens quand tu veux. Si ce n’est pas libre ici, tu vas là-bas, ou là-bas, il y aura toujours un coin pour toi, pour que tu avances ».
Je vais alors travailler pendant des semaines, profitant des confinements, des jours de chômage partiel, des samedi, des vacances. Je vais m’incruster, abuser du lieu. On ne me fera jamais la moindre remarque. Chaque fois que je croise Richard, je gratte des conseils qu’il prendra toujours le temps de me donner. Il me montre le chemin avec bienveillance et humilité. Je serai aussi le témoin de son travail sur le texte de Petit Boulot pour Vieux Clown, un spectacle dans lequel il est absolument formidable et bouleversant comme ses deux camarades de scène Serge Barbuscia et Pierre Forest. Richard Martin en train d’apprendre son texte, c’est un spectacle. Le texte est posé devant lui sur la table, il absorbe une phrase, penche son corps et sa tête en arrière, levant les bras, puis il se replie jusqu’à poser le visage sur les feuillets, comme dans une imprécation sacrée. J’aurais adoré voler ces moments avec mon téléphone mais je n’ai pas osé.
Le Livre de Jobi est maintenant pleinement devenu un spectacle. Je ne manque pas à la fin de chaque représentation, au plus fort encore des applaudissements, d’expliquer que sans Richard Martin et l’accueil du Toursky, je n’aurais jamais pu me me produire devant des spectateurs. C’est par la fréquentation répétée du Toursky, de ses scènes, sous ses projecteurs, dans le silence des salles vides, que je suis devenu comédien. C’est là que j’ai compris que la scène est un sas entre la vie et la mort, peuplé de fantômes avec lesquels on peut jouer en toute liberté. Richard Martin m’a transmis son feu. C’est un des hommes les plus courageux, sincères, humbles, humains que je connaisse.
Voilà ce que je voulais dire.
Richard Martin est partout au Toursky. Il est là même quand il est absent. Il s’occupe de tout. Il est derrière chaque pierre, chaque planche, chaque porte et surtout chaque décision. Il est aux commandes de ce vaisseau spatial qui nous mène vers les étoiles. Richard Martin a créé une utopie de culture. Le Toursky, c’est des spectacles, de théâtre ou de musique, des expos, des débats, des conférences. Tout se fait dans le plus grand sérieux et la plus grande convivialité. Il n’y a pas plus marseillais que le Toursky. Plus étrange, plus singulier, plus différent, ça n’existe pas. Et tous les artistes habitués à jouer sur toutes les scènes du pays ressentent cet esprit plein de charme du Toursky de Richard Martin. Alors, tant qu’il a l’envie et la force, la ville de Marseille ne peut que s’honorer à l’aider et le soutenir, et non pas donner ce spectacle déshonorant d’une politique étriquée et si peu visionnaire. Richard se battra jusqu’au bout et nous serons de plus en plus nombreux à ses côtés.
Et dire que c’est bientôt le Printemps des Poètes…
Thierry B. Audibert